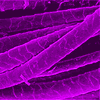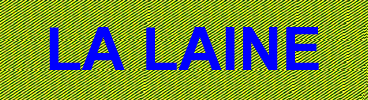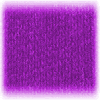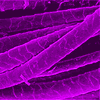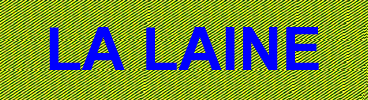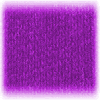Parmi
les poils d'animaux, la laine de mouton occupe une place de choix. C'est
un filament kératinisé comprenant une partie libre, le "fût",
se terminant en pointe, et une partie enfoncée dans le derme, la
racine, comprise
dans un sac, le follicule pileux ou bulbe, d'où pousse le poil.Ce
follicule présente un cycle évolutif saisonnier permettant
un renouvellement du pelage. Le nombre, le caractère, la disposition
des follicules déterminent la nature des poils et la structure
du pelage.
D'une façon générale, les toisons comportent deux
parties: l'une externe, constituée de longs poils destinés
à protéger l'animal contre les intempéries, et l'autre,
interne, constituant la fourrure proprement dite, le duvet très
fin, frisé, servant d'isolant contre la chaleur et la lumière.
L'importance relative de ces deux parties varie selon l'espèce
animale et même selon la saison (poil d'été, poil
d'hiver, mues...). Pour les moutons, et notamment le mérinos, qui
est à la base des élevages pour l'obtention de la laine,
il n'y a que la partie interne; la toison de l'agneau nouveau-né
rappelant celle du mouflon.
Au voisinage immédiat
des follicules se trouvent d'une part des glandes sudoripares qui sécrètent
le suint, constitué d'acides gras et de leurs savons de potassium
qui les rendent solubles dans l'eau, et, d'autre part, des glandes sébacées
produisant la suintine, composée de corps gras (lanoline), insoluble
dans l'eau.
Outre
ces constituants (fibres avec suint et suintine), la toison est souillée
de matières étrangères: sable, terre, débris
végétaux et autres. Pour une première élimination
avant la tonte, les moutons sont lavés à dos. Après
la tonte, les toisons sont lavées industriellement soit par passage
dans une succession de bains aqueux avec détergents (sur "léviathan"),
soit par soumission à des jets aqueux ou de solvant. La laine lavée
est séchée et ne contient plus que 0,5 % environ de corps
gras et quelques résidus végétaux (chardons, etc.)
à éliminer mécaniquement en filature.
La
laine se présente généralement comme une fibre dont
la section droite est quasi cylindrique. On a pris l'habitude d'appliquer
le terme laine aux fibres dont le diamètre moyen est compris entre
15 et 17 mm (micromètres). Les laines les plus fines (mérinos)
ont un diamètre compris entre 16 (cas exceptionnel) et 22 mm (micromètres).
Les laines provenant des "croisés" (moutons européens
croisés avec des mérinos) ont un diamètre moyen plus
élevé. Un des caractères essentiels de la laine est
la frisure, mesurée par le nombre d'ondes par centimètre.
Elle varie en raison inverse du diamètre (de 120 ondulations par
10 cm pour les plus fines à 12 ondulations par 10 cm pour les plus
grosses).
Du
point de vue anatomique, les fibres kératiniques sont constituées
du cortex , corps du poil, avec éventuellement la moelle et le
canal médulaire, continu ou discontinu (n'apparaissant que dans
le cas où la laine a un diamètre moyen supérieur
à 30 mm), et de la cuticule , extérieure.
Le
cortex est constitué d'un assemblage de cellules fusiformes. En
1953, les Japonais Horio et Kondo ont découvert que ces cellules
peuvent être de deux types morphologiques différents, répartis,
dans le cas des fibres frisées, en deux éléments
séparés par un grossier plan diamétral: le paracortex
et l'orthocortex. Doués de propriétés de gonflement
différentes, ces deux éléments se comportent comme
un bilame à l'origine de la frisure par croissance en ressort à
boudin des fibres à structure bilatérale.
La
cuticule est constituée en gros par des "écailles"
de formes diverses. Pour la laine, elles sont apparentes et bien dessinées:
leur structure est différente selon qu'elles sont accolées
à l'orthocortex ou au paracortex. La cuticule est à l'origine
des mouvements privilégiés dans un sens déterminé
par la disposition des écailles à "rebrousse-poil et
dans le sens du poil" qui permettent le feutrage.
La
laine est constituée essentiellement de kératines, qui sont
des substances de nature protéique. Les a-aminoacides H2N-CH(R)-COOH
(R étant un radical hydrocarbure, alcool, acide, phénol,
etc.) de la kératine sont au nombre d'une vingtaine dont notamment
la cystine avec son pont disulfure.
Les
kératines constitutives des cellules corticales sont de deux types.
Les unes, comportant des macromolécules hélicoïdales
(hélices alpha, selon L. Pauling) assemblées entre elles
comme les brins d'un retors, forment des microfibrilles. Les autres sont
composées de macromolécules en pelote, comme les globulines;
elles forment un ciment élastique qui unit les microfibrilles;
elles renferment la majeure partie de la cystine, qui les lie entre elles
et aux microfibrilles.
Le
taux de reprise de la laine est de l'ordre de 18 %, mais la laine peut
absorber jusqu'à 30 % de sa masse en eau sans pour cela paraître
mouillée. Les échanges thermiques avec le milieu extérieur
et le corps humain sont liés à cette "reprise"
d'humidité et déterminent les qualités de confort
particulières des articles de laine: l'absorption d'eau est exothermique
et la désorption endothermique.
Grâce à
leur structure physique en rapport avec la frisure des fibres, les filés
de laine emprisonnent un grand volume d'air (60 %) qui joue le rôle
d'isolant thermique.
Les propriétés élastiques de la laine sont liées
à la structure du cortex et à ses propriétés
hygrométriques. La laine se caractérise par une "reprise
élastique retardée" exceptionnelle qui fait qu'une
fibre de laine, déformée dans un pli par exemple, revient
lentement d'elle-même à sa forme initiale lorsque cesse la
contrainte et qu'elle se trouve en atmosphère humide (autodéfroissabilité,
mémoire de la forme).
Le
gonflement de la laine immergée dans l'eau fait ressortir davantage
les redents des écailles de la cuticule. Ce gonflement est accentué
par l'acidité ou la basicité du milieu aqueux ainsi que
par un accroissement de la température; aussi, les sollicitations
mécaniques dans ces conditions ont un effet de feutrage de l'article
en laine d'autant plus important: cette propriété est exploitée
pour l'obtention d'articles foulés; mais elle devient un inconvénient
dans le cas d'un tricot qui en feutrant rétrécit au lavage!
Cela a conduit à la mise au point de procédés antifeutrants,
notamment par dépôts de polymère sur les extrémités
des écailles pour en arrondir les redents.
La
laine résiste bien aux intempéries et brûle difficilement.
Traitée aux aldéhydes, elle garde aux températures
moyennes (jusqu'à 120°C) ses propriétés mécaniques,
ce qui détermine certains emplois industriels (feutres de séchage
en papeteries).
La
laine doit son caractère irremplaçable: à la complexité
de ses structures moléculaires fibrillaire et cuticulaire, qu'il
serait difficile de parfaitement copier, bien que sa structure bilatérale
ait inspiré la synthèse de fibres chimiques "bicomposées",
comme la fibre X403 de Rhône-Poulenc Textile; à ses finesses
et longueurs de fibres variables, en fonction desquelles elle est travaillée
soit en cycle peigné, soit en cycle cardé, permettant d'obtenir
une très large gamme d'articles.
|